Grossophobie · Militantisme · Couple ou Célibat | On en Parle ?
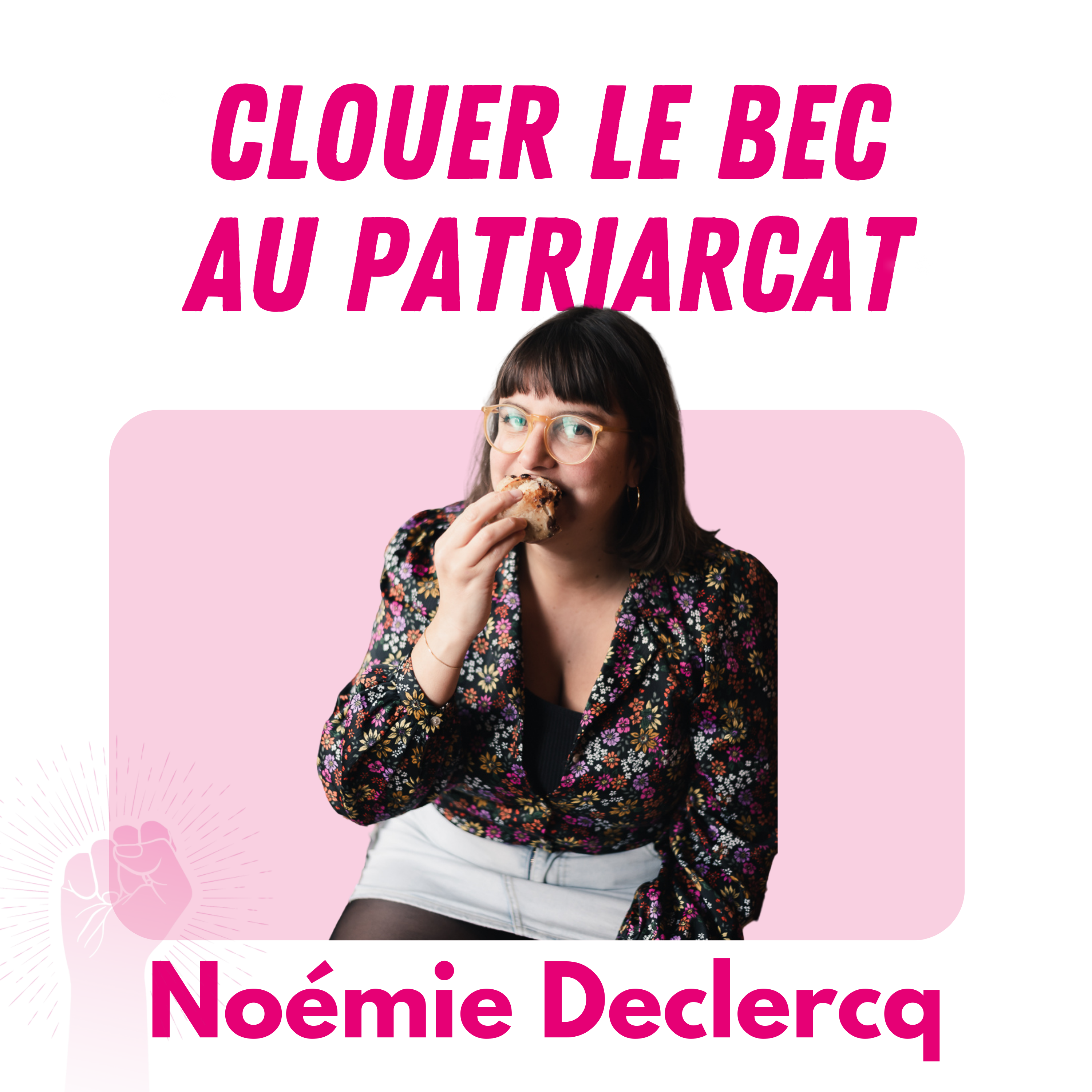
Grossophobie, militantisme et relations de couple : discussion avec Noémie Declercq
Dans ce nouvel épisode de Clouer le bec au patriarcat, j’ai eu le plaisir d’échanger avec Noémie Declercq. Ensemble, nous avons abordé la grossophobie et la manière dont elle imprègne notre société, les relations de couple et les dynamiques de pouvoir qui s’y jouent, et aussi le coût du militantisme. Parce que militer, c’est prendre conscience des oppressions, déconstruire, et parfois se heurter à l’incompréhension de son entourage. Une fois qu’on a mis les lunettes du féminisme, impossible de revenir en arrière, mais cette prise de conscience a un prix : celui des décalages qui se creusent, des résistances qu’on rencontre et parfois, de la violence du regard des autres. Avec Noémie, nous avons fait le tour de toutes ces questions et bien plus encore. Je vous partage ici quelques extraits marquants. Pour écouter l’épisode dans son intégralité, rendez-vous sur mon compte Instagram @clouerlebecaupatriarcat où vous trouverez tous les liens utiles en bio !
Qui est Noémie De Clercq ?
Je vais commencer par vous présenter Noémie et vous expliquer pourquoi j’ai voulu l’inviter dans mon podcast “engagé”.
Noémie Declercq, c’est une femme qui ne mâche pas ses mots. Elle est consultante en alimentation durable “et éthique” comme elle aime le préciser, parce que pour elle, ces enjeux vont bien au-delà de la simple question environnementale. Son engagement est multiple, profond, et surtout indissociable de ses valeurs féministes. Si elle devait se définir à travers ses luttes, elle se revendique sans hésitation comme anti-grossophobe, anti-classisme, anti-patriarcat, anti-capitaliste… La liste est longue et c’est vrai que Noémie le dit elle-même : elle est beaucoup dans l’anti. Mais derrière ce positionnement tranché, il y a une réflexion, une cohérence et une volonté farouche de lutter contre toutes les oppressions.
Derrière l’image d’une femme forte, inébranlable, il y a aussi une grande sensibilité. Son amie Lauriane la décrit comme un moelleux au chocolat : une croûte solide en apparence, mais à l’intérieur, c’est tout fondant, doux, sucré et intense à la fois. Un diamant brut, comme elle le dit si bien. Sa sœur, elle, la voit comme une vraie badass, une femme qui n’a pas peur de parler, qui sait prendre sa place et se faire entendre, mais qui, surtout, sait aussi écouter. C’est précisément cette force mêlée de sensibilité, cette capacité à se battre tout en restant profondément humaine, qui m’a donné envie d’inviter Noémie dans ce podcast où l’on va parler grossophobie, militantisme et relations de couple, amicales, la hiérarchie qu’on n’y met, qu’on n’y met pas, etc.
La grossophobie : comprendre et déconstruire cette discrimination
La grossophobie est une discrimination fondée sur le poids et l’apparence corporelle. Il ne s’agit pas seulement de remarques blessantes ou de moqueries, mais d’un système profondément ancré qui marginalise les personnes grosses dans tous les aspects de la société.
La grossophobie, c’est quoi ?
La grossophobie, ou “fat shaming” en anglais, désigne la peur d’être gros et la stigmatisation des personnes en surpoids. Elle se manifeste dans de nombreux domaines de la vie quotidienne : accès aux transports, aux soins médicaux, aux vêtements ou même à certaines pratiques comme la PMA.
Noémie explique avoir pris conscience de cette oppression en lisant un livre de Sofie Hagen, une humoriste et autrice danoise, qui décrivait des situations du quotidien qu’elle avait elle-même vécues. Elle réalise alors que ce qu’elle percevait comme des inconforts personnels était en réalité le reflet d’une société qui exclut les personnes grosses.
Exemples de discrimination grossophobe
Noémie donne de nombreux exemples de la manière dont la société n’est pas adaptée aux personnes grosses :
- Les transports : les sièges de bus, de train ou d’avion sont souvent trop étroits. En avion, il faut parfois acheter un deuxième siège, ce qui représente un coût supplémentaire injuste.
- Le mobilier : les chaises avec accoudoirs, les tabourets hauts, les sièges de cinéma ou de théâtre sont souvent inadaptés.
- L’accès aux vêtements : très peu de magasins proposent des tailles au-delà du 44, ce qui oblige les personnes grosses à commander en ligne.
- La médecine : la “grossophobie médicale” est un vrai problème. Des patients se voient refuser des traitements ou reçoivent des conseils inappropriés. Certaines procédures médicales, comme la fécondation in vitro, sont interdites aux personnes au-delà d’un certain IMC, un critère arbitraire qui prive certaines femmes du droit à la parentalité. La pilule du lendemain est dosée pour un poids maximal de 80 kg, ce qui signifie que certaines femmes doivent en prendre deux (Une information que même certains professionnels de santé ignorent !).
Et il y a bien encore d’autres exemples…
Grossophobie intégrée et remarques toxiques
Au-delà des discriminations institutionnelles, la grossophobie s’infiltre dans les interactions quotidiennes sous forme de micro-agressions :
“T’es pas grosse, t’es bien proportionnée.”
“Au moins, toi, t’as un beau visage.”
“Fais attention à ta santé !” (Alors que les personnes minces qui fument ou boivent ne subissent pas les mêmes remarques.)
Noémie souligne à quel point ces commentaires, même lorsqu’ils se veulent bienveillants, participent à une culture où le fait d’être gros est perçu comme un problème à régler.
Est-ce qu’un homme gros souffre des mêmes préjugés qu’une femme grosse ?
Noémie nuance sa réponse en disant que, oui, un homme gros peut souffrir des mêmes choses qu’une femme grosse, mais peut-être un peu moins… Elle explique que les femmes ont une « carte à jouer » dans la perception de leur corps, notamment parce que certains traits associés à la grosseur peuvent être considérés comme séduisants. Elle cite par exemple les courbes de Marilyn Monroe et l’idéal de la femme pulpeuse. En revanche, il n’existe pas d’équivalent positif aussi évident pour les hommes.
Mais au-delà de ces différences de perception, elle revient à l’intersectionnalité : être une femme grosse est forcément plus compliqué qu’être un homme gros, tout simplement parce qu’être une femme implique déjà une double pression sociale. Cela dit, elle conclut en avouant qu’elle ne sait pas vraiment si la grosseur est plus difficile à vivre en tant qu’homme ou en tant que femme. Si vous avez un avis sur le sujet, n’hésitez pas à m‘en faire part en commentaire ⬇️.
Déconstruire la grossophobie : un engagement militant
Prendre conscience de la grossophobie, c’est déjà un premier pas vers le changement. Pour Noémie, cela passe par l’acceptation de son corps et l’affirmation de son identité : “Je suis grosse, pas ronde. On dit bien ‘grosse voiture’, ‘gros portefeuille’, alors pourquoi refuser le mot quand il s’agit de moi ?”
Elle milite aujourd’hui avec l’association Fat Friendly, qui organise des groupes de parole et des espaces bienveillants pour échanger sur ces problématiques. Elle insiste sur le fait que chacun doit remettre en question ses préjugés et s’éduquer sur ces questions pour bâtir une société plus inclusive.
Militer dans un monde qui ne veut pas voir
Militer, c’est vivre en permanence dans un monde qui n’a pas mis ses lunettes. Un monde où l’on voit les injustices, où l’on analyse les structures oppressives alors que tant de gens autour de nous continuent à avancer les yeux fermés. Pour moi, cette prise de conscience est une source de colère et surtout de tristesse, d’autant plus que j’accompagne depuis quinze ans des femmes victimes de violences et de manipulations. Je me heurte régulièrement à des réactions difficiles à encaisser, même de la part de proches : « Tu es trop radicale », « On ne peut plus parler avec toi », « Tu ne vois plus que ça. » Ce fossé d’incompréhension est pesant.
Noémie, elle, a développé une autre approche. Prof en haute école, elle considère que son rôle est d’enseigner un cadre éthique aux nouvelles générations, de leur donner des clés pour éviter le greenwashing, le social washing et toutes les formes d’oppressions systémiques. Face aux gens qui ne sont pas déconstruits, elle adopte une posture plus détachée : soit ce sont des amis de longue date qu’elle aime profondément et alors, elle patiente, soit ce sont des nouvelles connaissances et, dans ce cas, ciao 👋 ! Pour elle, il ne sert à rien de perdre du temps avec ceux qui ne veulent pas voir…
Ce qui lui permet de prendre du recul, c’est aussi son militantisme écologique. Elle sait que, quoi qu’elle fasse, la planète va droit dans le mur. Elle sait que ses efforts, individuellement, ne suffiront pas à inverser la tendance. Alors, elle applique cette même logique à ses autres luttes : le féminisme, la grossophobie, etc. Il n’y a pas d’objectif concret, pas de deadline où l’on pourra enfin se dire que c’est gagné. On fait toutes de notre mieux et tant pis s’il y a des cons. C’est triste, oui, mais c’est comme ça…
Pourtant, même avec ce détachement, Noémie garde espoir. Elle croit au pouvoir des petites graines. Pas forcément en convertissant les gens au militantisme, mais en leur permettant, petit à petit, de se déconstruire. Comme cette amie, qui, après des années à refuser de dire le mot gros en lui préférant ronde, a fini par s’excuser et promettre de faire attention. « Mais putain, j’ai tout gagné ! » Ça a pris du temps, oui. Mais le temps est peut-être nécessaire pour que les choses bougent, surtout quand les gens ne sont pas prêts !
Pourquoi faudrait-il forcément être en couple pour être épanoui·e ?
Dans cette dernière partie de notre interview, j’ai eu envie d’aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur : la hiérarchisation des relations. Pourquoi le couple est-il toujours vu comme l’accomplissement ultime ? Pourquoi l’amitié, la solitude choisie ou d’autres formes de liens ne seraient-elles pas tout aussi légitimes ? Avec Noémie, on a échangé sur cette pression sociale qui nous pousse à croire que l’amour romantique est la clé du bonheur et sur la façon dont le féminisme nous a aidées à questionner (et parfois à rejeter) cette idée.
Personnellement, je me sens entourée, aimée, heureuse, sans avoir besoin d’un couple pour valider mon bonheur. Pour moi, le couple n’est pas “l’apogée”.
Noémie partage cette vision, mais son expérience est teintée d’un autre combat : celui d’assumer son célibat face aux attentes de son entourage. Elle ne veut pas d’enfants, elle le sait depuis longtemps, mais elle voit bien que cela la place un cran en dessous dans la hiérarchie sociale, même parmi les féministes. On célèbre toujours plus celui ou celle qui trouve l’amour que celui ou celle qui cultive ses amitiés ou s’épanouit seul·e. Sur les applications de rencontre, c’est flagrant : le simple fait d’écrire “Je ne veux pas d’enfants” lui vaut une quasi-invisibilité. Pourtant, elle ne comprend pas cette norme selon laquelle le couple et la parentalité seraient synonymes de bonheur ultime. Ceux qui ont des enfants n’ont pas l’air forcément plus heureux qu’elle…
Le couple devrait être une source de joie, un espace où l’on explore des choses différemment des autres relations. Sauf que, dans la réalité, c’est rarement le cas… Trop souvent, c’est compliqué, énergivore, plein d’incertitudes : est-ce que je plais ? Est-ce qu’il me plaît ? Est-ce que je l’aime pour ce qu’il est ou pour ce qu’il m’apporte ? Toutes ces questions fatiguent Noémie. Elle met déjà tant d’énergie dans d’autres aspects de sa vie, pourquoi en rajouter dans une relation qui n’apporte pas une évidence ? Parfois, elle se dit qu’une thérapie pourrait l’aider à y voir plus clair… Mais aussitôt, elle réalise qu’elle n’a pas envie de changer. Elle ne veut pas se forcer à chercher l’amour juste parce que la société lui dit que ce serait mieux ainsi.
Avec Noémie, on est partis dans tous les sens. On a ouvert des parenthèses dans les parenthèses, mais c’est bien la preuve que ces sujets nous passionnent. On a envie d’en parler, de les partager, de les diffuser et surtout de semer des graines chez celles et ceux qui nous écoutent. Alors merci d’avoir pris le temps de lire cet article !
Je vous quelques références dont Noémie a parlé :
- La BD “Ne jamais couler” de Marie De Brauer qui parle du combat qu’elle mène aujourd’hui contre la grossophobie.
- @corpscools sur instagram
Bien sûr, n’hésitez pas à me suivre sur @clouerlebecaupatriarcat si ce n’est pas encore fait et si le cœur vous en dit, à découvrir mon livre Clouer le bec au patriarcat. Et grande nouveauté : il y a maintenant une newsletter ! Abonnez-vous via mon site 💻 !

